Dans le monde du travail, tout le monde ne parle plus que de ça. « Compétence » par ci, « compétence » par là, les « compétences » sont déclinées à toutes les sauces. Sur LinkedIn (entre autres) chacun se gargarise de faire valoir les siennes. Les « compétences » sont devenues le Graal ultime et le monde scolaire, toujours en manque d’une énième nouvelle évolution, a sauté sur l’occasion pour prendre le train en marche. Aujourd’hui, il exhibe ses biceps avec fierté, heureux d’inculquer aux élèves ces fameuses « compétences ». Des « compétences langagières », comme des « compétences en résolution de problèmes » quand il ne s’agit pas de « compétences transversales ». Bref des « compétences » à toutes les sauces.
Certains pourraient être tentés de voir tout ça d’un très bon œil. Après tout, quoi de plus naturel que l’école prenne en compte les apports de la recherche et qu’elle fonctionne en synergie avec le monde professionnel ? La question mérite d’être posée. Pour y répondre, convoquons à la barre les plus éminents spécialistes des questions relatives à l’activité mentale, à savoir les psychologues cognitivistes.
Des expériences concrètes
La psychologie cognitive a ceci d’intéressant que, contrairement à certains courants des sciences humaines, elle fait valider ses recherches par des expériences concrètes. En psychologie cognitive, on n’assène pas des hypothèses comme étant des vérités sans passer par la phase de la preuve, comme c’est souvent le cas dans les sciences éducatives notamment. Je dis bien « souvent » tant il est faux d’avoir une opinion négative de l’ensemble des sciences de l’éducation. Car en sciences éducatives également, les études empiriques de terrain permettant de vérifier la pertinence des hypothèses existent. On les dénomme généralement « données probantes » et elles peuvent nous éclairer avec une bonne précision sur ce qui relève de l’idéologie ou de la découverte scientifique. Malheureusement, elles sont à ce jour largement minorisées, pour ne pas dire ignorées par nos facultés universitaires de sciences éducatives et autres écoles pédagogiques. Pour des institutions qui se targuent d’offrir un enseignement de niveau tertiaire, ce manque flagrant d’ouverture aux perspectives discordantes est pour le moins inquiétant. Si on désire réellement offrir des formations dignes de ce nom, il est urgent d’y remédier et d’offrir au courant des « données probantes », la place qu’il mérite dans la formation des futurs enseignants. Mais je m’égare. Revenons à la question centrale qui nous occupe, à savoir celle des « compétences ».
Depuis longtemps déjà, les cognitivistes se sont intéressés à des sujets ayant trait au champ de l’expertise. Les recherches menées en 1894 par Binet sur Giacomo Inaudi, un super calculateur capable de résoudre des opérations arithmétiques complexes (ex : extraction de racines, additions et soustractions de plus de 20 chiffres, élévation au carré d’un nombre de 4 chiffres, etc) en un temps record, peuvent être considérées comme précurseures en la matière. Entre autres expérimentations, Binet a opposé Inaudi à un simple caissier de supermarché choisi au hasard dans la résolution d’opérations arithmétiques assez simples, comparables à celles que réalisait le caissier dans son quotidien (ex : 27*8).
Le triomphe du caissier
Le résultat, pour stupéfiant qu’il puisse paraitre, fut sans appel : le caissier calculait plus rapidement. Sans en avoir conscience, Binet venait de découvrir un fait aujourd’hui largement reconnu par les sciences cognitives, à savoir que les connaissances dont on dispose importent plus qu’une éventuelle capacité générique à traiter l’information dans le cadre d’une résolution de problème. Autrement dit, que les connaissances sont l’élément principal de toute forme de « compétence ».
Ce constat fut corroboré dans les années 60 suite aux travaux menés par un autre cognitiviste de renom : De Groot. De Groot s’est intéressé aux capacités des plus grands maitres d’échecs. Son intuition était que les meilleurs joueurs possédaient une capacité d’analyse en profondeur supérieure aux autres. Il mit donc sur pied une série de tests pour vérifier. Mais, à son grand dam, rien ne vint valider son hypothèse. De Groot ne parvint en fait qu’à identifier une seule et unique différence significative entre les joueurs d’élite et les joueurs plus ordinaires : les premiers mémorisaient nettement mieux les différentes configurations de l’échiquier.
Son expérience fut répliquée une dizaine d’années plus tard par Simon et Chase qui démontrèrent que la supériorité affichée par les grands maitres disparaissait dès lors que les pièces étaient placées de manière aléatoire, soit dans des configurations jamais rencontrées lors de véritables parties d’échecs. Il devenait dès lors difficile d’imaginer que ce fut autre chose que l’ensemble des parties jouées et/ou mémorisées au fil des ans, autrement dit les connaissances spécifiques des grands maitres sur le sujet, qui fondaient leur expertise.
L’effet Saint Matthieu
En parallèle, l’expérience permit d’établir un second fait d’importance, à savoir que plus on possède de connaissances sur un sujet, plus on en acquiert de nouvelles facilement, un fait aujourd’hui unanimement reconnu dans le domaine des sciences cognitives et qui porte le nom d’ « effet Saint Matthieu ». Ce dernier tire son nom de l’évangile de Saint Matthieu selon lequel « on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a ». Avec le temps, l’« effet Saint Matthieu » a été validé par de multiples expériences suivant un canevas assez similaire : des chercheurs font venir dans leur laboratoire des personnes spécialisées dans un domaine (par exemple en football, en danse ou en circuits électroniques) et des personnes qui ne le sont pas. Ils font lire à chacun une histoire ou un article court suffisamment simple pour que même les non spécialistes en comprennent tous les détails. Ils font ensuite revenir ces gens le lendemain et leur demandent de restituer ce dont ils se souviennent du texte en question. Sans exception aucune, les spécialistes se souviennent mieux.
Afin de valider qu’il ne s’agit pas là que d’une question d’attention découlant de l’intérêt propre des participants, les chercheurs ont mis sur pied une seconde expérience au cours de laquelle ils ont demandé à des personnes d’apprendre soit beaucoup, soit peu d’informations relatives à un domaine qui leur était jusque là inconnu (par exemple les comédies musicales). Ils ont ensuite fait lire aux deux groupes d’autres informations, nouvelles également, sur le même sujet et se sont rendus compte que ceux qui avaient appris plus de choses sur le sujet dans un premier temp apprenaient les nouvelles informations plus vite et plus facilement que les autres, et ce indépendamment de toute forme d’intérêt personnel.
Toujours au cours de la même période, un autre chercheur, Yntema s’est penché, lui, sur le cas des contrôleurs aériens. Ces derniers étant amené à gérer d’énormes masses d’informations dans leur quotidien, Yntema fit l’hypothèse qu’ils avaient développé une expertise « transversale » dans la gestion de grandes quantités de données. Autrement dit, qu’ils étaient capables de mieux gérer de grands volumes de données et ce dans n’importe quel domaine en comparaison d’autres gens. Yntema en fut lui aussi pour ses frais. Car dès lors qu’ils se retrouvaient dans un domaine qui n’était pas le leur, à savoir une tâche d’association de lettres, de couleurs, de signes etc., les contrôleurs aériens n’obtenaient pas de meilleures performances que le commun des mortels. Le clou fut enfoncé par Bisseret quelques années plus tard, qui démontra que les contrôleurs aériens reprenaient l’avantage dès lors que certaines connaissances spécifiques propres à leur domaine étaient réinjectées dans la tâche à accomplir.
Ce rapide descriptif des expériences démontrant la place centrale des connaissances dans le développement de l’expertise pourrait être poursuivi longtemps. Je me contenterai de signaler une dernière expérience, qui me parait intéressante, ayant trait à la compréhension d’un article de journal. Elle fut menée aux Etats-Unis et opposa des lecteurs chevronnés ne connaissant rien au baseball à des fans de ce sport ayant des difficultés à lire. Les deux groupes durent répondre à des questions portant sur un article parlant de baseball. Et à nouveau les amateurs de sport, donc ceux qui avaient des connaissances spécifiques plus poussées, réussirent mieux et surpassèrent ceux qui disposaient d’une meilleure maitrise de l’instrument de lecture.
De nombreuses études encore furent menées afin d’essayer de démontrer l’existence d’hypothétiques « compétences » distinctes des connaissances, mais à ce jour aucune d’entre elles n’a obtenu des résultats aussi significatifs, ce qui fait dire à André Tricot, autre cognitiviste de renom, que cet aveuglement du monde scolaire au sujet des connaissances est parfaitement incompréhensible.
Car au final, en privilégiant la piste des « compétences » (dont, en passant, l’existence même est contestée dans les domaines transversaux que sont l’esprit critique, la créativité ou la collaboration par d’autres grands noms de la psychologie cognitive tels que John Sweller ou Paul Kirschner – mais cela sera le sujet d’un autre billet), l’institution scolaire péjore le développement même de ce qu’elle prétend améliorer.
Illustrons la chose très simplement. En privilégiant la piste de la compétence communicative aux connaissances, l’école contribue à développer des élèves forts en gueule mais qui ne savent pas de quoi ils causent. Dans les langues étrangères, le cas est encore plus emblématique puisqu’on prétend développer la capacité à s’exprimer tout en privant l’enfant du vocabulaire qui permet justement de s’exprimer. Il devient dès lors difficile de prétendre qu’il parle mieux, sauf à considérer qu’il puisse s’exprimer par gestes ou par le biais des anglicismes partagés. Pour une société qui se veut société de la connaissance, avouez qu’il y a là quelque chose qui interpelle…
Des questions ignorées
Plus grave encore peut-être, en mettant de côté les connaissances, l’école diminue les capacités de jeunes à poursuivre leurs apprentissages. Car comme il a été démontré plus haut, des élèves qui maitrisent moins de connaissances sont des élèves qui auront plus de difficultés à en acquérir de nouvelles. Là aussi, étant donné le contexte qui se veut de formation continuelle, il y a de quoi s’interroger. Apprendre à apprendre ne passe-t-il pas en définitive par faire le nécessaire pour simplifier au maximum ces fameux apprentissages ultérieurs ?
Des questions qui devraient être traitées et qui, malheureusement pour la jeunesse, restent aujourd’hui tout simplement ignorées par les institutions en charge du dossier. Il serait opportun que nos responsables se saisissent réellement du sujet à bras le corps et cessent de se laisser porter par des slogans ou des effets de mode…
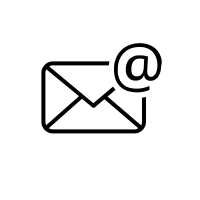






Comments are closed.