Le punk rock passait à la radio, l’avenir semblait possible, nos colères étaient pures.
Deux adolescents jouaient au basket, seuls, sur un terrain situé près des ateliers de la compagnie nationale de chemins de fer. L’un, timide et sensible, mesurait près de deux mètres. L’autre, un petit teigneux sec comme un coup de trique, écorché vif, tentait de redonner une direction à une jeunesse interrompue trop vite. Il pleuvotait et le ballon glissait. Personne ne possédait encore de téléphone portable parmi les gamins qui venaient au terrain, si bien qu’il fallait passer des heures entières à shooter seul pour espérer croiser quelqu’un contre qui jouer un match l’espace de quelques minutes. On écoutait du punk rock en ce temps-là chez les petits blancs, et les colères se dirigeaient encore contre le conformisme droitier des Églises (combien sont ceux qui, comme moi, ont usé leurs disques de « Bad Religion » une croix autour du cou !) , contre les policiers, parfois – pour les plus experts – contre les mangeurs de viande.
Plus tard, des photos de Che Guevara ou des drapeaux suisses allaient remplacer les posters de Kevin Garnett et de Michael Jordan dans nos chambres, mais confusément, au nom d’un maelström de colères de jeunes mecs prépubères, nous ne voulions déjà plus du monde qui s’offrait à nous, de ces « career opportunities » qu’avaient si bien su vomir les Clash avant nous.
Aujourd’hui, je veux dire à ces adolescents que je ne les ai pas trahis, que je ne saurai toujours pas m’accommoder du bonheur que l’on me proposait déjà à quinze ans : mettre des lunettes Oakley, porter des pantacourts et rouler vite dans une bagnole fluo. Seulement, ceux qui symbolisaient parfois la liberté lorsque nous cherchions des modèles, rebelles professionnels et bouddhistes de salon, ceux-là ne peuvent plus rien pour moi, comme ils ne pouvaient déjà rien pour nous à l’époque. Maladroit, notre anarchisme d’adolescence avait ceci de pur qu’il était sans objet. Il ne constituait pas la base arrière d’où nous allions construire une carrière universitaire, ou une œuvre philosophique pour salons de coiffure, comme l’écrivain François Bégaudeau.
Désormais la quarantaine, je suis resté anarchiste. Je ne crie plus « ni Dieu ni maître », car j’ai un Dieu, et des maîtres que je veux simplement choisir moi-même. Singulière naïveté, trouvez-vous ? Mais n’est-il pas autrement plus naïf d’accepter sans broncher que nos autorités nous ferment musées et bibliothèques en fonction de statistiques lorsque la grippe est mauvaise, et que ce soit à nous de défendre la nécessité d’un socle minimal de valeurs ?
Jusqu’au bout, je refuserai catégoriquement les standards d’une civilisation qui prétend présenter les supermarchés comme des « mondes passionnants» à faire découvrir aux bambins, selon les termes d’une annonce de la coopérative de magasins suisses Migros datant de l’été 2020. Mon catholicisme tragique et flamboyant ne refuse pas le monde, il le vomit souvent, le domine rarement, le combat toujours. Mais enfin, il est dedans. Il ne sympathisera pas de sitôt avec une anthropologie mortifère dont il assurerait le service après-vente, soucieux, comme un poisson mort, de suivre le courant.

La quarantaine approchant, je suis également devenu monarchiste. Car là seul réside encore l’espoir de reconstruction d’une société à peu près digne de ce nom. Idée ridicule ? Romantique ? Sans doute, mais idée qui nous dirige vers des contrées de l’esprit auxquelles les médiocres n’auront jamais accès. Par fidélité à ma jeunesse, je suis devenu sujet patagon.
D’adolescent en rupture, je suis devenu un père ombrageux. De cette époque m’est cependant resté le besoin de rire. Le monde qui vient est tellement stupide, tellement orgueilleux, tellement sur les nerfs, surtout, qu’il me semble parfois qu’un seul fou rire suffirait parfois à envoyer valser ses ambassadeurs. Lorsque des agents de police étaient envoyés pour sanctionner un restaurateur qui a eu le tort d’offrir un coup de blanc à un septuagénaire contraint d’attendre sa commande dans le froid, afin de ne pas attraper le Covid, qu’aurions-nous dû faire si ce n’est nous moquer des autorités qui les envoyaient ? Lorsque des personnalités de prétendument anticapitalistes ne voient pas quel problème il pourrait y avoir à user tous du même idiome, à regarder les mêmes séries – certains en font même un combat, comme le terrifiant député français Louis Boyard – et à s’indigner des mêmes fadaises, comment réagir autrement que par un grand rire souverain ? Notre monde est devenu si lourd, si terriblement sentencieux, que nous ne marquerons jamais mieux la distance qu’en riant aux éclats.
Car en nous habite encore la vie.
*
J’ai passé mon enfance à attendre qu’elle me quitte. Couché sous mon grand poster des « Aristochats », dessin animé devenu politiquement incorrect depuis cette époque, j’attendais le sommeil en écoutant d’une oreille le déluge des mitraillettes des films d’action qui, à l’époque, n’avaient pas encore été remplacés sur les écrans par des concours de cuisine ou de chansonnettes. Je rêvais de devenir Arnold Schwarzenegger tandis que mes fils, aujourd’hui, devront se construire devant Téo Lavabo. Dans cette chambre, mon enfance était également bercée par les airs de Bach, lorsque le programme était au sublime, ou par les rires provoqués par la série « Benny Hill », chaque dimanche soir sur France 3. Je n’ai d’ailleurs jamais su s’il était vraiment drôle, le grassouillet Benny Hill, avec son vieux compère, ses course-poursuites et sa petite musique finale. Ce que je crois pouvoir affirmer aujourd’hui avec certitude, cependant, c’est que ce programme brisait des interdits, ceux de l’époque, et qu’il n’en reste aujourd’hui plus rien. Les barrières morales sont tombées et les rires ont disparu avec elles.
Que Dieu nous garde,
Raphaël
Pour soutenir mon travail avec un don: https://www.lepeuple.ch/#don
Don via Tipeee: https://fr.tipeee.com/en-enfer-il-y-a
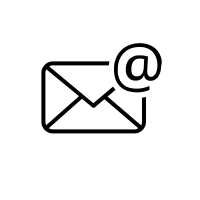






Les commentaires sont désactivés.