Elle habitait dans la gare du village où je suis né. De sa cuisine, elle dominait le monde.
Chers amis, Chers camarades,
Lorsque j’étais enfant, une retraitée me gardait en me nettoyant les oreilles, en me faisant manger du Cenovis pour que je me renforce. Elle habitait un petit appartement qui dominait le village où je commençais mon existence, coincé au sommet d’une gare massive, vestige d’un temps où la localité était encore prospère. La prospérité, à vrai dire, n’était jamais arrivée jusqu’à elle, mais j’ignore si elle l’avait jamais placée dans son champ des possibles.
Elle n’était pas du genre à se plaindre, mais rétrospectivement je peux concevoir que sa vie n’avait pas toujours été une partie de plaisir, entre un mari parfois rude et une condition modeste. Pendant dix ans, cette femme m’a choyé et préservé d’un concept éculé : le vice. Je me souviens d’elle me cachant les yeux au moment où des images d’un Woodstock passaient à la télé, avec ses spectateurs qui se roulaient dans la boue. Je peux encore l’entendre s’indignant des manières de Michael Jackson, toujours à se frotter les parties dans ses chorégraphies, un slip argenté porté au-dessus de costumes que n’aurait pas renié un Kadhafi des grands jours. Que dirait-elle aujourd’hui en écoutant Téo Lavabo chanter « Chipolata » en moule-bite, devant une famille sous sédatif ?
Cette dame toute simple, issue de l’immigration, avait un sens très aigu de ce qui était convenable ou non, et pourtant je ne crois pas qu’elle était particulièrement portée sur la religion, en dépit de ses origines. D’ailleurs, sans que je sache encore à l’heure qu’il est si c’était en raison d’un quelconque ancrage à gauche, elle ne m’a jamais acheté que des Pif et Hercule, et jamais cette abomination capitaliste que représentait le Picsou magazine. Chez elle, on buvait des Orangina, qu’elle cachait dans un réduit auquel n’importe quel voleur aurait pu accéder.

Cette dame toute simple, issue de l’immigration, avait un sens très aigu de ce qui était convenable ou non, et pourtant je ne crois pas qu’elle était particulièrement portée sur la religion, en dépit de ses origines. D’ailleurs, sans que je sache encore à l’heure qu’il est si c’était en raison d’un quelconque ancrage à gauche, elle ne m’a jamais acheté que des Pif et Hercule, et jamais cette abomination capitaliste que représentait le Picsou magazine. Chez elle, on buvait des Orangina, qu’elle cachait dans un réduit auquel n’importe quel voleur aurait pu accéder.
C’était un autre temps, un temps où l’on pouvait encore s’étonner que d’aucuns ne respectent pas la plus élémentaire des solidarités. Avec sa générosité et sa dignité, elle nous faisait rêver, mon frère et moi, avec les seuls bonbons à la menthe de la Migros qu’elle gardait au-dessus du frigo. Son mari, parti avant elle auprès du Père éternel, nous rendait fiers en nous taillant un bâton pour aller marcher à ses côtés et nous a même donné un goût momentané, jamais réapparu depuis en ce qui me concerne, pour les glaces à la pistache.
On ne parlera de cette dame dans aucun manuel d’histoire, mais avec elle c’est le monde d’avant qui a disparu, voilà quelques années. Un monde sans Internet, un monde souvent sans bagnole, sans portable, sans grands moyens, mais un monde digne. Qui saura, si je ne le dis pas ici, qu’elle se mettait toujours entre les voitures et moi, parce que si le destin décidait que c’était elle que devait heurter un camion, elle pensait que ce ne serait pas bien grave ? C’était une femme du commun, mais d’exception, et aucun universitaire ne se penchera jamais sur son histoire.
De sa cuisine, elle dominait le monde. De sa fenêtre, je la vois encore me dire adieu, ma main dans celle de ma mère. Je ne l’ai jamais appelée parson prénom ni même tutoyée.
C’est pour elle que je veux empêcher le monde de se défaire.
Elle fut ma reine. Elle le reste.
Raphaël Pomey
Illustration: la gare de Vallorbe
G CHP/Wikimedia Commons
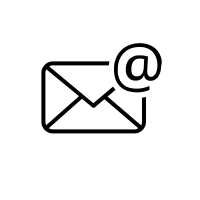






Les commentaires sont désactivés.