Chante, ô Muse, le bonheur d’élever des enfants dans la compagnie des poules et des cochons.
Chers amis, Chers camarades,
Au début du millénaire, j’avais passé plusieurs vacances en Égypte dans des hôtels très confortables où ma mission sur cette planète consistait à faire de la musculation, me baigner et manger beaucoup. C’était absolument bête et méchant mais je dois admettre que ces parenthèses de vide existentiel me convenaient tout de même assez bien, étant de nature plutôt bileuse. Mes escapades au Gouvernorat du Sinaï Sud ont hélas pris fin en 2004, après qu’un immense yacht avait explosé sous mes yeux au milieu de la nuit, tandis que je lisais mon Kerouac à l’abri des Russes bourrés aux bides immenses.
Des spécimens, les Russes pas les yachts (quoique), d’ailleurs livrés en duopack avec petites amies anorexiques de dix-neuf ans. Dès le petit matin suivant, on nous avait expliqué qu’il n’y avait pas de souci à nous faire et que la double dose de militaires qui encadraient désormais le Mövenpick Resort s’inscrivait dans un tournus tout à fait standard, mais j’admets avoir eu quelques doutes sur le moment. Cet épisode, couplé avec une vague tentative d’enlèvement l’année précédente, m’avait convaincu que la Norvège, finalement, possédait aussi quelques vertus.

Si je vous parle de cela c’est parce que cela fait un sacré moment que je n’ai pas fait des vacances balnéaires, et ce n’est pas durant cette quinzaine automnale que j’ai pu changer la donne. Et l’étonnant, dans l’histoire, c’est que je ne m’en porte pas beaucoup plus mal. Bien sûr, j’aimerais visiter Rome avec mes gamins, manger des choucroutes monumentales en Allemagne et leur infliger du haggis en Ecosse. Mais je sais aussi que développer de projets, comme cette infolettre ou mon journal, prend du temps. L’existence est un marathon, bien davantage qu’un sprint et je vous remercie d’ailleurs de faire un bout de piste à mes côtés.
Le bonheur de vivre en Vaudois
Si je supporte bien la simplicité de mon cadre de vie actuelle, c’est que j’aime farouchement mon bout de pays, sa lourdeur, sa lenteur. Je vis à dix minutes de la gare de la deuxième ville du Canton, mais ici, c’est encore le chant de coq qui me réveille. Bon, un peu aussi celui des gamins qui nous appellent pour ne pas aller aux toilettes tout seul, soyons honnête. Parfois, j’imagine le Parisien qui viendrait se balader dans mon village et qui tomberait, médusé, sur le distributeur automatique de fondue situé à cent mètres de ma maison. Sûr que le boug, comme disent les ados, en ferait trois tweets et tout autant de stories sur Instagram ! Mais chez nous, c’est dans l’ordre des choses. C’est bien. C’est comme ça. Comme les familles unies, les enfants qui n’ont pas encore été poussés au changement de sexe et les bières Boxer dont les capsules te niquent la main à l’ouverture mais qui seront de toutes les fêtes villageoises jusqu’à la fin des temps.
J’aime particulièrement ce pays lorsque vient l’automne. Un brouillard dense prend possession des environs, des blaireaux (l’animal, pas le fan d’escape games) et des chevreuils commencent à se balader entre les champs et le bout de forêt qui sépare mon patelin du suivant. Tout est calme, serein, et on comprend que le tempérament local est fondamentalement protestant, même quand la foi n’est plus guère qu’un lointain souvenir. On commence à se préparer des tartes à la raisinée, certains rangent religieusement leurs bûches pour pas crever de froid le soir, on trouve des courges en self-service au bord des routes… Ce qui me surprend, c’est que lorsque j’exprime ma joie, toute simple, d’être enraciné dans une telle région, d’aucuns me rétorquent que la grisaille leur pèse, de même que l’humidité et la relative fraîcheur qui s’installe, alors même qu’ils jugent ces mêmes éléments tout à fait romantiques et dépaysants en Irlande. J’aime beaucoup l’Irlande, croyez-moi bien, mais je ne suis pas, comme disait l’écrivain Chesterton, « le Casanova des nations ». Je préfère ma région, paisiblement, sans intérêt particulier pour la couleur de peau des gens qui participent à son bon développement.

Éducation sexuelle low cost
Hier matin, avec mes enfants, nous sommes allés rendre visite aux cochons que le père de copains du village a installé au milieu des champs. Les bestiaux ne bougeaient pas et mes gamins ont commencé à imiter leurs grouinements pour les attirer. Cette fois, ça n’a pas marché mais nous nous sommes marrés et avons enchaîné avec une visite aux poules, en extérieur, qui tapent systématiquement des sprints pour venir nous dire bonjour. L’une était un peu déplumée et mon fils aîné a expliqué à mon cadet que c’était parce que le coq « l’aimait beaucoup ». Est-ce que j’ai encore besoin d’une neurasthénique avec un collier en bois pour venir donner des cours d’éducation sexuelle à mes gosses, après ça ? C’est d’ailleurs une fort belle chose, que la compagnie des bêtes. A peu près chaques vacances, mon gamin demande à aller bosser dans la ferme du voisin, dont nous achetons les dindes, les pigeons ou les lapins. Imaginez le gosse dans son bleu de travail qui se réjouit d’aller nettoyer des enclos alors qu’il possède une Switch à la maison ! J’ai peut-être loupé pas mal de choses dans la vie, mais une telle scène me laisse à penser que ce ne sera pas forcément le cas de ma descendance. Enfin restons humbles : ils finiront peut-être par s’engager en politique, il y a des choses que l’on ne maîtrise pas.

Toutes ces considérations m’ont amené à me replonger dans l’œuvre de Chesterton, que je citais un peu plus haut. Chesterton est un auteur de l’émerveillement, quelqu’un de loufoque qui trouvait une raison de s’extasier devant à peu près n’importe quoi. Il écrit, dans un livre quelque chose qui résume assez mon sentiment présent : « Dès qu’on s’enracine quelque part, on ne voit plus l’endroit où on est. Nous vivons à l’instar d’un arbre, avec toute la force de l’univers. » Une remarque qui lui permet d’ajouter que « le globe-trotteur vit dans un monde plus étroit que celui du paysan ». Si je partageais avec vous mes enthousiasmes d’excentré, ce n’est donc pas uniquement par esthétique. C’est parce que cette lourdeur que je vante ici, est à mon sens le signe de la fertilité. Le signe d’un pays qui n’a pas sombré dans le morbide, l’infantilisation, l’impersonnel. « L’homme qui se dresse dans son potager, avec un monde fabuleux s’ouvrant à sa porte, est un homme aux grandes idées », précise l’auteur anglais.
Je vous ai régulièrement dit comment la marche forcée vers la pseudo-décroissance m’agace. Pour autant, il y a de grandes joies dans une simplicité volontaire, peut-être parmi les plus hautes de l’existence. Je doute que les écolos des villes, qui se sentent autorisés à donner des leçons aux gens de mon village parce qu’ils achètent des graines importées du Pérou en grande surface, oui je doute que ces gens les connaissent réellement.
Que Dieu nous garde,
Raphaël Pomey
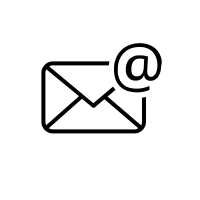






Les commentaires sont désactivés.